Kiosque > fiche livre
Un jeune garçon
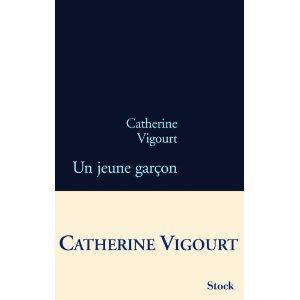
CatherineVigourt, Un jeune garçon , Paris, Stock, 2010, 188 p, 17 €
Elle écrit pour « régler son compte une bonne fois à l’alliance impossible des mots « parole » et « famille »
Une famille (mais n’est-ce pas tellement courant ?) où l’on ne parle pas de ce qui dérange. Une famille où règne le non-dit, le silence, le mensonge, l’aveuglement, comme si dire, faisait exister les choses et que le risque ne se puisse affronter… comme si ne pas dire, permettait d’effacer la réalité… Un leurre qui fait des dégâts ! Des vies gâchées, des enfances pourries parce qu’ont manqué les mots pour expliquer ce qui se passait…
Oui, c’est dur de dire à un enfant, ton frère est malade parce qu’il aurait fallu d’abord pouvoir se dire mon fils est malade … ou mort ou drogué. Pour pouvoir dire aux autres, il faut, d’abord, pouvoir se le dire à soi même, et regarder les choses en face.
Pouvoir oser parler de la maladie, du deuil, comme de l’alcool, des drogues, de la folie. Les enfants ont besoin de repères, de savoir, de compréhension, pour donner du sens à leur réflexion et à leur vie.
Chacun a la liberté, toujours, tout au long de sa vie, de donner la parole, le dire, aux générations suivantes en s’interdisant les secrets, fameux secrets de famille si ravageants et dont on repère, en analyse, combien l’insu est toujours, inconsciemment, su. Ne pas dire, c’est s’octroyer un pouvoir sur l’autre, détenir un savoir auquel on ne lui donne pas accès, donc être dans une forme de tout puissance… Mais à quel titre, au nom de quel statut ?
Il ne s’agit pas de donner des détails sordides aux enfants, mais bien de leur expliquer la mort, la maladie, le suicide d’un proche ; que ça a été un choix, que personne n’y peut rien et que ce choix se doit d’être respecté. Si des parents arrivent à transmettre ça à leurs enfants, ils leur épargneront des symptômes ultérieurs, pour leur existence d‘adultes. Et ce, parce que les choses se gravent inconsciemment et ressortent un jour ou l’autre sous des formes étranges et indéchiffrables (sauf pour un analyste) qui peuvent handicaper une vie et engendrer de fâcheuses répétitions.
Mieux vaut prendre le temps de l’échange et la responsabilité de créer des fondations, pour que la vie ne transforme pas les carences en fortifications. Parce que les fortifications enferment et peuvent un jour se fissurer, voire exploser.
C’est la démonstration que fait ici l’auteur : elle désamorce la bombe à retardement de la colère qui l’a dévastée face à cet empêchement à dire. Le déni familial, elle a buté dessus inéluctablement, sans fin, sans remède, sans issue.
Jusqu’à ce jour où il faut pourtant bien renaître. « Je saisis ce matin-là que la pesanteur n’est pas obligatoire, que la joie se vole ».
Mais quel chemin pour en arriver à se libérer. Par l’écriture, elle ose s’exposer, exposer la jalousie, le fiel, le drame, le tragique, la déchéance, la violence, la décrépitude, les crises de folie de ce frère enfin mort, qu’elle a tant haï, de son vivant, et qu’elle peut haïr et dire haïr, malgré qu’il soit mort.
Décrire avec la froide distance de la rancœur combien la drogue est un cataclysme pour un être, mais aussi pour ses proches, pour la famille entière ; rien n’y résiste, elle balaye tout sur son passage, ouragan de douleurs partagées . Et cependant, si « on n’en finit pas avec ce qui est fini. On peut sortir toutefois. Faire un tour »
Florence Plon