Kiosque > fiche livre
Le travail social est un acte de résistance
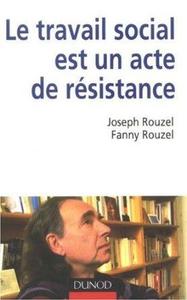
Fanny et Joseph Rouzel, Le travail social est un acte de résistance, Dunod, 2009.
I-
Recension de l’ouvrage « Le travail social est un acte de résistance » de Fanny et Joseph Rouzel, Paris : Dunod, 2009.
Par Jacques Cabassut.
De quoi « Rouzel » est-il le nom ?
Tel pourrait être en effet le titre de l’ouvrage « Le travail social est un acte de résistance ». C’est à la fin de ce dernier que l’on apprend que Jeannette, résistante du réseau breton nommé « turquoise », mourra à Ravensbruck en mars 1945. C’était la tante des « Rouzel » qui pour la première fois sont réunis ici dans l’acte d’écriture. Ainsi, l’acte de résistance, dans le travail social, contre l’idéologie postmoderne, comme durant les périodes sombres de notre histoire, est une affaire sérieuse où chacun joue sa vie, même si le plus souvent c’est de son existence dont il s’agit.
A la conceptualisation du travail social à laquelle Joseph se coltine depuis plusieurs années, tant sur un plan clinico-théorique que politique (création du site internet Psychasoc, de PSF -Psychanalyse sans frontière-, les colloques passés et prochains, d’Asie – Association des Superviseurs Indépendants Européens-) répond ainsi le témoignage de sa sœur, Fanny Rouzel. Le livre expose finalement cette résistance en acte qui donne le sens de ce double travail d’écriture : outre la dimension éthique et clinique, c’est le politis , la vie dans la cité, le « vivre ensemble » des humains dont il s’agit ; et ce, à un moment où justement les « humanités » dans le champ du savoir et des métiers de la relation humaine sont touchés. Si la valeur d’une culture ou d’une société se fonde sur la façon dont le lien social s’établit, de l’un à l’Autre, y compris à cet Autre en soi que Lacan nomme inconscient, alors cet ouvrage par sa simple existence pose la question de la résistance éthique de chacun à partir de la niche occupée par chacun, et en particulier dans le champ du travail social. « Au fond, les humains tiennent ensemble parce qu’ils habitent le langage et que le signifiant s’articule ». (M-J Sauret, L’effet révolutionnaire du symptôme, Erès, 2008, p 17).
La question d’Oury « Qu’est-ce que je fous là ? » à mon poste de travail auprès des démunis, des SDF, des personnes en fin de vie... ? n’en finit pas de résonner au fil des pages. Ce pourquoi l’ouvrage pourrait constituer une référence actuelle auprès des travailleurs sociaux… ou bien rebuter ceux qui n’auraient pas été portés par une culture institutionnelle, une transmission du travail social ou qui préféreraient l’efficacité des échelles ou autres évaluations quantitatives au questionnement éthique. Ils pourraient alors à leur tour résister. L’ambition de rendre compte de l’engagement, de la responsabilité et de l’impossible de l’acte et de l’action (au sens où pour Freud éduquer, soigner, gouverner sont des métiers impossibles), voire de défendre le désir du travailleur social (au sens où il existe un désir de l’analyste pour Lacan) pourrait en décourager plus d’un, et alimenter donc une autre forme de résistance a la lecture. Pour les autres, l’analyse de la novlangue actuelle dans laquelle sont pris les établissements spécialisés et/ou de formation de la santé, du social et du médico-social (Itep, Irts, Cemea…) via les récents textes de loi et les politiques actuelles, pourrait s’avérer utile. Il en va de même pour les différentes alternatives proposées par réintroduction de fictions théoriques et autres éprouvés cliniques transféro-contre-transférentiel au centre de nos dispositifs tant institutionnels que de pensée…
Il me vient en effet à l’esprit, alors que j’écris ces lignes, que j’étais en cette fin d’année 2009 à la librairie Lipsy pour la sortie-dédicace de l’ouvrage commun de « l’appel des appels », en présence de Roland Gori, Serge Portelli, B. Cassin, C. Laval, etc.. Ce livre s’inscrit clairement dans cette mouvance, ou plutôt dans un discours, au sens lacanien du terme celui de « remettre l’humain au cœur de la société », qui n’est autre que le mot d’ordre de « l’appel des appels ».
Sans arrêt, l’élaboration de l’un, résonne l’éprouvé de l’autre, sans que toutefois un clivage se forme entre une pensée et une illustration de celle-ci dans la pratique. Ce point est particulièrement intéressant : Joseph Rouzel, fort de son expérience en la matière, articule les mots et la Chose, la théorie à la pratique, parfois avec quelque malice où les anecdotes de l’histoire familiale côtoient habilement la grande Histoire ou la praxis du travailleur social. Remise en jeu de la dimension de sujet (de l’inconscient) et du symptôme (analytique), remise en cause des notions de handicap, de dysharmonies, d’anomalies, de dysfonctionnement, de soins au lieu du thérapeutique…, résistance à la novlangue postmoderne donc, je le répète, qui se décline au quotidien des pratiques, de l’écriture de la clinique et de l’épreuve de la rencontre, autant de thèmes que J. Rouzel déconstruit pour que cesse la technique, (la fameuse boîte à outil du travailleur social dans lequel celui-ci puiserait l’outil adéquate en fonction de ses besoins !) pour que se construise plutôt la méthode (analytique), dans une mise en mouvement de la dite (ce que l’on nomme l’heuristique). J. Rouzel est freudien (donc lacanien) : le réel et le transfert n’intégreront aucune boîte à outil qui se transformerait illico en « bric à brac » praxique. Il y préfère le « rubrique à brac », ces albums de B.D réalisés par Gotlib, dessinateur talentueux au références multiples, celles-là même que J. Rouzel utilise (les misérables de Hugo, la méditation bouddhiste, Kafka, Pierre Perret…. ) là où Gotlib les aura mises en bandes dessinées.
F. Rouzel traite également du réel. Mais elle ne l’imprime pas de la même façon. Peut-être parce qu’il l’aura marqué, évidemment, comme personne. Son style, vif et rapide, nous livre quelques pépites d’actes bruts qui impliquent le lecteur en l’obligeant à élaborer ses écrits. Ainsi à propos de cet accompagnement jour et nuit d’une personne âgée en fin de vie, lorsqu’elle écrit sans autre forme de procès, qu’elle n’est pas allée à son enterrement. Le sens de cet acte éthique devra être donné par le lecteur.
Le point commun pourrait consiste dans la mise de départ « il n’y a de résistance que de l’analyste » nous enseigne Lacan. Il n’y a donc de résistance que du travailleur social. L’ouvrage tente finalement de d’établir en ces périodes troubles ce fameux « Holding de holding » cher à C. Allione : face aux récents textes de loi réglementant nos pratiques, aux démarches qualité et autres théories du management de l’humain appliquées au social, au médico-social ou à la santé, le plus grand danger est bien le sujet, qui à l’instar d’Eichmann, ne sera préoccupé que par le départ de « ses » trains à l’heure. Résister, d’un point de vue analytique, est donc un mot à plusieurs entrées. Il peut signifier également la résistance comme défense (de la rencontre, psychique, etc…), la surdité ou l’aveuglement à ce qui se passe pour soi comme pour autrui. Il est donc utile que cette question là soit abordée versus défensif.
Puisque la figure du résistant est omniprésente, le lecteur pensera peut-être à Marie Durand, victime de la révocation de l’édit de Nantes et de l’interdit du protestantisme, à qui l’on attribue le fait d’avoir gravé en occitan sur la pierre de la tour de constance, dans la cité médiévale d’Aigues Mortes, le terme de « register ». Elle avait été enfermée dans ce qui était alors une prison pour femmes, en 1730 pour en ressortir en 1768. Sa captivité durera 38 ans, durant lesquelles elle devra résister à la pauvreté, le froid, la promiscuité. Ce que Fanny Rouzel partage avec les plus démunis pour lesquels elle écrit et « illustre » ce quotidien de l’éthique sur lequel J.Rouzel écrit quelques chapitres auparavant.
L’ouvrage donne quelques raisons « de ne pas désespérer Billancourt » (Badiou est d’ailleurs souvent cité) certes d’un point de vue éthique, clinique, conceptuel et politique mais aussi et surtout en réhabilitant de fait ce « Moment fraternité » souligné par Regis Debray (2009, NRF-Gallimard). Ainsi terminerai-je par ce dernier qui dans L’intellectuel face aux tribus, Hommage à Samir Kassir ( Paris, Cnrs Editions, 2008), écrit ceci : « Le berger conduit le troupeau : modèle sémitique, prophétique, monarchique. Le tisserand entrecroise patiemment la chaîne et la trame, fougueux et modérés, réformistes et conservateurs, musulmans et chrétiens, pour faire une seule et même toile, la Cité. Ainsi peut s’unir sans se mélanger, fondre sans confondre. Modèle hellénique. Puisque tels sont au dire de Platon, dans son dialogue sur le Politique, les deux modes possibles de formation d’un collectif : le pastoral et le tissage. »
Ainsi, en guise de réponse à ma question initiale, dirai-je que les Rouzel sont peut-être le nom des tisserands actuels ….
II- Interview pour les Editions Dunod par Brigitte Cicchini
1/ Comment définiriez-vous ce livre écrit à deux, mais de façon très distincte ?
Le point commun entre ma soeur Fanny et moi-même c'est l'engagement dans un métier du social, engagement au sens politique et clinique. Ma soeur, après des études dans le champ de l'animation (BEATEP, DEFA) et du travail social (AMP) a exercé pendant plusieurs années auprès d'adultes malades mentaux, en privilégiant des espaces d'expression,. Aujourd'hui elle accompagne des personnes en fin de vie avec toute la souffrance liée à cet accompagnement, qui est fait de rencontres, de morceaux de vie quotidienne partagés, de tristesses et de joies. La difficulté étant que ce genre de travail se fait dans une totale solitude. D'où son recours à l'écriture pour se ressourcer, mettre des mots sur l'insupportable, témoigner, faire savoir ce qu'est la vie de ces personnes vieillissantes reléguées dans les oubliettes de l'espace social. Je partage avec elle cet engagement: pas de travail social sans un positionnement politique ferme. Les travailleurs sociaux, ces fantassins de l'intervention sociale, sont aux avant-postes de la misère, de l'injustice, de la ségrégation. Il luttent à corps perdu, avec les moyens du bord, contre une situation sociale qui ne cesse de se dégrader. Une situation qui piétine les plus faibles, les plus démunis, les étranges et les étrangers. C'est une position éthique qui nous réunit. Pour ma part j'ai exercé longtemps dans le champ de l' éducation spéciale. D'abord dans les années 70 en franc tireur, dans une communauté en Catalogne du nord; puis dans un lieu d'accueil dans le Gers. Et, une fois accomplie les études d'éducateur spécialisé à Toulouse, période qui fut l'occasion de maintes rencontres , Tosquelles, Capul, Puyuelo etc, j'ai travaillé auprès d'adultes, puis d'enfants psychotiques, de toxicomanes et enfin de jeunes en rupture sociale. Je suis ensuite passé à la formation aux CEMEA de Toulouse, puis à l'IRTS de Montpellier. En désaccord avec les « usines à gaz » que sont devenus les centres de formation, j'ai créé il y a 10 ans l'Institut européen psychanalyse et travail social (PSYCHASOC) à Montpellier. Avec une vingtaine de collègues formateurs j'y ai développé un style d'enseignement en travail social qui allie de façon rigoureuse théorie et pratique, en s'orientant de la psychanalyse. D'aucuns parlent aujourd'hui, à propos de cette approche originale de la formation, de « L'école de Montpellier ». Notons que cela ne va pas sans mal: dans un champ de la formation gouverné en sous-main par des modèles qui privilégient la technique et l'adaptation à la tache des salariés, au détriment du sens, il est difficile de ramer à contre-courant pour développer un véritable espace d'élaboration de la pratique, qu'il revient à chaque professionnel d'opérer en permanence. D'où l'intérêt que nous portons à l'enseignement et à l'exercice de la supervision, que ce soit en formation ou dans les institution où nous intervenons. Nous avons d'ailleurs développé un outil spécifique, qui constitue la colonne vertébrale de nos formations, l'instance clinique. J'en ai rendu compte dans mon ouvrage « La supervision d'équipes en travail social » paru chez Dunod en 2007.
L'ouvrage qui met en scène ce cheminement, pour ma soeur et moi-même, passe par des chemins différents, mais est ancré dans des convictions politiques et éthiques communes. Conviction que l'on peut rassembler sous le terme de « communiste », au sens noble du terme, au-delà des dérives que l'on a fait subir à cette noble idée. Une éthique du sujet ne se soutient que de la prise en compte des espaces collectifs où il s'insère. Autrement dit nous menons de front travail social et engagement politique. Au sens où Jacques Lacan affirmait: « L'inconscient, c'est le social. » C'est comme une bande de Möbius. Il n'y a pas le sujet d'un côté et le social de l'autre, mais une continuité de l'un à l'autre. Pas de développement du sujet sans social; mais pas de développement social sans sujet. C'est donc bien au sens où Marx l'entendait, la libération des peuples et des individus qui constitue la ligne d'horizon du travail social, comme du combat politique. En cela psychanalyse et politique constituent les deux faces de la même médaille.
2/ Comment pourrait-on lutter contre l’usure et l’isolement des travailleurs sociaux ?
La lutte contre l'usure et l'isolement des travailleurs sociaux (« trouvailleurs soucieux », comme je les désigne souvent) prend tout son élan de ce que je viens de dire. Il s'agit de faire-savoir ce que l'on fait. Non seulement pour rendre des comptes, légitimement exigés par les financeurs (Etat, Collectivités locales etc), mais aussi de rendre compte. Les travailleurs sociaux en mal de reconnaissance n'ont que cette voie pour obtenir cette reconnaissance réclamée à cor et à cris. Peu de citoyens savent, et encore moins comprennent, ce que fabriquent les travailleurs sociaux: à eux de le faire savoir. Ce sont des métiers de l'ombre, invisibles. Ecrire, prendre la parole dans des colloques, témoigner de sa pratique, parler à la radio, la télé etc voilà donc une première voie qui s'ouvre contre l'usure et l'isolement. L'expression seule révèle une action qui autrement ne se voit pas. L'usure vient toujours d'une perte de sens. Alors qu'un professionnel en accord avec lui-même, comme nous essayons de l'être, ma soeur et moi-même, peut être fatigué, mais comme nous le disait notre mère, étant petits: c'est de la bonne fatigue! Je reçois beaucoup de professionnels (éducateurs, assistants sociaux, psychologues, directeurs...) qui sont usés de cette perte de sens. Ils viennent en formation pour se ressourcer, retrouver le goût et la saveur du métier. Voici donc une deuxième voie: se former en permanence, interroger sa pratique, revisiter les fondamentaux, les valeurs, les principes qui forment les fondations de l'action social et dont les Droits de l'homme et la démocratie républicaine et laïque, assurent les fondations. Et enfin dernière voie: ne jamais oublier le collectif, qui se décline en équipe,institution et réseau de partenaires. Un établissement est une entité abstraite faite de textes de référence, de budget, d'organigramme, de règlements, etc Pour faire institution, « instituer la vie », comme le dit si bien Pierre Legendre, il est indispensable de prendre en compte les multiples articulations entre tous ceux qui constituent l'établissement et lui donne vie: usagers comme professionnels. Voici donc une autre façon de lutter contre l'usure et l'isolement: se parler! La parole tisse le lien social.
3/ Vous évoquez votre visite au Québec, ce modèle est-il transposable en France ?
Même si nous pouvons tirer des leçons pertinentes de ce voyage au Québec, il ne faut pas penser transposer cette expérience singulière. Les modèles ne sont pas clonables et la situation a changé La désinsititutionnalisation de l'hôpital psychiatrique au Québec était soutenue par une volonté et un véritable engagement des politiques. Nous n'avons pas, ou plus, comme après guerre, en France cette conjoncture. Le discours dominant que ce soit dans la santé mentale ou dans le champ de l'action sociale, tire plutôt vers des modèles rétrogrades, qui vont de l'enfermement des jeunes délinquants à la camisole chimique des psychotiques. Ce qui prime c'est de faire peur aux bons citoyens et par des actions d'éclat médiatique de leur laisser croire qu'en muselant tous les facteurs désignés à la vindicte publique (fous, asociaux, drogués, marginaux etc) tout le monde sera tranquille. De plus le contexte de mondialisation a aussi sérieusement changé la donne. Le rouleau-compresseur du néolibéralisme touche aujourd'hui le secteur social, jugé jusque là non rentable par les Etats, mais que les fonds de pension et autres financiers commencent à investir. Il y a, alors que d'autres domaines sont bouchés pour l'investissement, de l'argent à faire avec les handicapés, les délinquants, les toxicomanes, les exclus etc.. C'est cynique mais nous en sommes là. J'en voudrais pour preuve le rachat par un fond de pension d'une clinique psychiatrique à Montpellier; ou la privatisation d'un service d'aide aux chômeurs dans le Nord. On pourrait multiplier les exemples. Comment allons-nous résister à cette financiarisation effrénée du champ social?
4/ La réglementation du travail social et le poids de l’institution ont-ils déshumanisé l’approche du travail social ?
Non, ce qui a déshumanisé le travail social, ce ne sont pas les textes. La loi 2002-2, par exemple est remarquable d'ouverture, encore faut-il apprendre à l'interpréter. Ce n'est pas non plus l'institution dont je dis qu'elle relève de la dynamique d'un collectif humain. Ce qui produit aujourd'hui une véritable séisme dans l'intervention sociale, c'est le modèle dominant du néolibéralisme, qui transforme toute action ou production humaine en marchandise. Les effets s'en font sentir progressivement dans le travail social. Privatisation progressive des services; mise en place de procédures d'évaluation (la démarche-qualité) calquées sur l'industrie; contrôle tatillon et bureaucratique des actions; deresponsabilisation des professionnels à travers une « armée mexicaine » de chefs et de sous -chefs qui produisent une véritable balkanisation des équipes; détournement des fonctions de direction par des professionnels issus de la banque ou du BTP qui ne comprennent rien au travail social et prônent un management issu de l'industrie ; formations de plus en plus formatées, où un saucissonne digne du Père Ubu en domaines de compétences et autres référentiels, fait perdre toute cohérence dans un parcours de formation; invasion des écrits et des échanges par une novlangue, qui offre comme caractéristique de ne rien signifier, si ce n'est l'allégeance d'une « servitude volontaire » au pouvoir. etc... Cela pose fondamentalement, pour poursuivre dans ces métiers, dont le coeur est justement l'humanisation et la transmission de l'humain, la nécessité d'une position subversive. Autrement dit, je l'ai souvent répété, il s'agit d'être rusé, pas au sens d'une tromperie, mais au sens de la metis de grecs. Etre rusé, c'est naviguer en eaux troubles, sans se troubler, sans perdre son cap. C'est utiliser les moyens du bord, faire flèche de tout bois. C'est aussi faire jouer les contre-pouvoirs, sans illusion, sans idéalisme. C'est faire appel à l'opinion éclairée du public etc. Bref toute une stratégie d'espoir et de résistance s'ouvre là. Il ne s'agit ni de se plaindre, ni de se résigner. C'est de cela dont les professionnels du travail social viendront témoigner lors de notre 3 ème congrès « Travail social et psychanalyse » qui se tiendra du 4 au 6 octobre 2010 à Montpellier. Le thème central de cette rencontre est, comme dans cet ouvrage : la résistance.
Joseph ROUZEL, Psychanalyste,
Directeur de PSYCHASOC
11, Grand Rue Jean Moulin
34000 Montpellier
Tél : 04 67 54 91 97
Portable : 06 73 09 05 60
Fax: 04 67 66 79 52
Courriel :
site : http://www.psychasoc.com
Site ASIE (Association des superviseurs indépendants européens)
E-mail: