Kiosque > fiche livre
Archives incandescentes
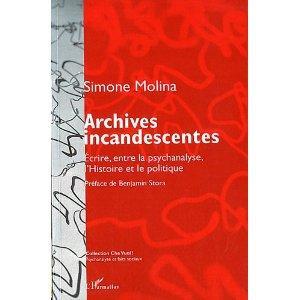
Simone Molina, Archives incandescentes , L’Harmattan, 2011, 27€, 274 p.
Rainer Maria Rilke[1] introduit ses Lettres à un jeune poète comme suit : « demandez-vous à l’heure la plus silencieuse de votre nuit : « suis-je vraiment contraint d’écrire ? »... Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple « je dois », alors, construisez votre vie selon cette nécessité. »
C’est un peu le sujet de cet essai époustouflant. Qu’est-ce qui amène un sujet à écrire ? Et surtout à écrire pour témoigner d’un vécu subjectif de l’horreur d’un traumatisme à dimension collective. Là où s’articulent le un, et les autres. Lorsque le un par un rejoint le semblable.
Préoccupée depuis toujours par ce questionnement, Simone Molina engrange dans sa bibliothèque quantité d’ouvrages sur tous les génocides et autre atteintes à l’humanité par l’homme lui-même. Archives sur la Shoah, guerre d’Algérie, et persécutions des juifs depuis Isabelle la Catholique (au nom si bien porté !) de 1492 jusqu’à nos jours récents de régimes vichyssois et autres fronts nationaux d’extrême droite.
L’écrivain se heurte, comme l’historien, à un problème : la disparition de la plupart des archives brûlées à grand soin par les protagonistes, la censure, et le tabou liés à ces documents qui révèlent ce que l’homme est capable de faire à l’homme et dont il n’est, dans l’après-coup, pas trop fier. Où se situe la marge de manœuvre de la liberté d’écrire sur les génocides dont on a été victime ? Faut-il témoigner, raconter sur le mode de la fiction, trouver un ton et un style dont on puisse se satisfaire pour dire l’indicible, l’inracontable, le cauchemar dont personne ne veut rien savoir ? Peu d’écrivains s’y sont confrontés : Robert Antelme, Jorge Semprun, Primo Lévi qui, par son suicide a mis un point d’orgue à ce dire du devoir de mémoire.
Les historiens se détournent, ou occultent ; il faut du temps pour que des nouvelles générations s’emparent d’une histoire qui n’appartient pas à leurs souvenirs.
Mais ceux-là qui écrivent pour survivre ? Ou parce qu’ils sont les rares survivants de populations entières décimées. Où se situent leur place et leur devoir ? Face au déni des protagonistes, des politiques, des historiens ? La fiction ne risque-t-elle pas de dénaturer la rigueur et le tranchant obscène des faits ? Qui peut s’autoriser et comment ? Depuis Shoah, de Lanzmann, jusqu’à La liste de Schindler, les débats sont houleux et la controverse âpre.
Xénophobie, racisme, ségrégation, ne fondent pas le socle d’une Histoire dont on se vante et touche de trop près, sur le mode le plus négatif, l’éthique du sujet. Le silence fait loi.
Car il s’agit bien d’une transgression de l’interdit de dire les effets de trauma, sur plusieurs générations ; des chercheurs avancent dorénavant qu’ils sont en mesure de prouver que des viols peuvent avoir des retentissements sur l’ADN des générations suivantes, de par la trace qui s’imprime sur les corps, parallèlement au psychisme. La haine exclut toute symbolisation.
A fortiori quand la vérité des mots ultérieurs est interdite, en ce qui concerne les exils, attentats, pogroms, génocides, le silence d’une génération vient faire écran pour les suivantes et transmet un non-dit qui vient étouffer la capacité d’advenir comme vivant, la capacité à s’ancrer dans des racines, et prive d’une transmission générationnelle.
Les descendants s’inscrivent alors dans cette catégorie du non symbolisé. Et dès lors et malheureusement quelque chose insiste toujours et ressurgit ailleurs, comme le refoulé, là où ce n’était pas attendu.
« L’abrogation du réel passe par celle de la mémoire… Etre le fils d’un ennemi du peuple était dangereux, mieux valait faire comme si cela n’avait pas eu lieu. Ainsi tout un peuple faisait-il comme si cela n’avait pas eu lieu »[2] Pas de commémorations pour les guerres sales, pas de reconnaissance pour les victimes, pas de restitution symbolique.
Comment lutter contre cet oubli de ce que l’on cherche à oublier, c’est ce à quoi les analystes et les historiens sont confrontés. Leur cheminement présente un aspect commun. Ils optent pour ce risque inouï de « se mesurer avec ce qui demeure à l’état de trace et ne cesse de vouloir s’abimer dans l’oubli ». Ces passeurs de l’oubli, qui s’animent dans leurs écrits d’un statut de médium pour relier l’être du passé avec l’être d’avenir, dégagent une ouverture.
Un sujet se constitue de sa recherche de lui même, en lui même et sur lui-même ; c’est ce que nous démontre la psychanalyse. Le discours se constitue de l’histoire qui se répète, puis se constitue dans le récit. Face à un autre qui écoute, s’inscrit le pouvoir des mots, et surtout ce qui leur échappe et s’en échappe. Là, pas de marge de manœuvre ou tergiversation : l’être est nu, pris dans les affres du Réel et se restitue à lui-même le contenu de ce qui l’a marqué, de manière indélébile, et dont le quotidien se fait répétition jusqu’à ce que la cure l’en délivre.
Le sujet, la fiction, le réel s’entrelacent comme un nœud borroméen jusqu’à ce que la peur de ce qui a été vécu disparaisse, au profit de ce qui est à vivre. Entre mots et silences, entre obscurité et transparence se tisse un discours où le symbolique, à travers la fiction, apprivoise le réel. C’est la responsabilité du psychanalyste de favoriser, par son désir propre, et grâce à l’équation du transfert, ce passage.
Si la création fait signe, dans la sublimation, d’une mise au travail du symptôme, elle peut aussi fait signe du sinthome et s’imposer comme étayage pour un sujet pris dans le registre de la psychose. De l’étranger on passe à l’étranger à lui-même.
Cette partie plus clinique entrelaçant psychanalyse, psychose et écriture, traite du trauma initial de la forclusion du Nom-du-Père, dans son empêchement à se dire, dans cette expérience radicale de l’absence et de l’opaque, sans division subjective, ni identité advenue. Le retour dans le Réel de ce qui n’a pu se symboliser met le sujet face à l’effroi, et dans l’errance. A cette effroyable énigme, l’écriture parfois peut faire bord. Ainsi vont les ateliers d’écriture…
La psychanalyse reste un des rares et derniers lieux de confidentialité dans ces temps de traçabilité et transparence et étiquetage. Elle laisse le règne à l’altérité, au silence, à l’imprévisible. Improviser des solutions est mieux que d’entrer dans les statistiques. Quand va-t-on renoncer aux dégâts du cognitivisme, arrêter d’évaluer, de découper le sujet en portions rééducables et réadaptables à merci. Le recul de la psychanalyse dans les institutions est l’infâme corollaire d’une psychiatrie qui se saborde dans les impasses du tout sécuritaire et de la camisole chimique.
Psychanalyse et écriture permettent de rendre du mouvement, de remettre en marche le symbolisé, la mise en mots, et redonne du sens qui produit du vivant.
La psychanalyse rend l’accès à soi, l’écriture l’accès aux autres ; parfois il faut les deux.
Elles affrontent tous les dangers, osant amener un sujet à puiser en lui la force de devenir vivant ; elles ont l’art d’être contre le déni, le refoulement, l’hallucination, le morcellement, mettant en mots le cri qui n’est que silence …
Ecriture, poésie, analyse comment mieux faire appel à l’Autre que par ce biais, et en vivre pour survivre ?
Citant Charlotte Delbo,
« Parce que ce serait trop bête
Que tant soient morts
Et que vous viviez
Sans rien faire de votre vie. »,
l’auteur démontre qu’elle a su, par sa clinique, son écriture, son écoute, faire quelque chose de sa vie.
L’incandescence de ses propos brûlera les mains de ceux qui, s’emparant d’un tel ouvrage, n’en voudront rien savoir.
Florence Plon
[1] Rainer Maria Rilke Lettres à un jeune poète , p. 18, Grasset
[2] E. Carrère, Limonov , 2011 Pol, p 244
Archives Incandescendes
Simone Molina et commentaire de Florence Plon
mardi 10 avril 2012