Kiosque > fiche livre
Les vies extraordinaires d’Eugène
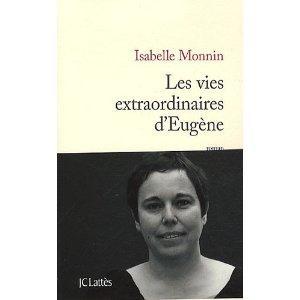
Isabelle Monnin, Les vies extraordinaires d’Eugène, Paris, JC Lattès, 2010, 234 p., 17€
Comment qualifier le ton, le style de ce roman ? Original, dépouillé, moderne, vrai, juste, cinglant, cru, désopilant, cynique, désabusé, remarquable ?
L’auteur, pour cette première œuvre, ne recule devant rien, pas même devant ce sujet qui n’est pas des plus faciles à traiter : la mort d’un enfant.
IVG, IMG, fausses couches, éclampsies, grands prématurés entre la vie et la mort… La mort d’un bébé, tout embryon soit-il, marque à jamais la mère, le père, le couple. Isabelle Monnin retrace le chemin du deuil que parcourent des parents, chacun d’eux cherchant sa solution pour faire face à l’insoutenable émotion devant l’insupportable.
Le deuil d’un enfant n’est pas seulement celui d’une absence : c’est aussi celui, et c’est le pire, d’un avenir qui ne se vivra pas, d’un échange à peine esquissé, trop tôt interrompu, d’une frustration implacable qui tient tête au manque et à la privation.
On reste saisi devant cette confrontation désarmante aux machines, aux soignants, aux informations médicalisées, dont l’échec ramène immanquablement à l’angoisse de ce qui se profile, à cette terreur devant l’irrémédiable, la tragédie de la perte de ce qui n’a qu’à peine été.
On ne se remet pas de la mort d’un enfant, on y survit ; le temps remanie la perception de la douleur, mais ce vécu ne s’efface pas.
Paradoxalement, donner la vie, c’est aussi donner la mort et l’on n’y pense guère sur le moment et heureusement ; mais une mort, bien sûr, en son temps, à la fin d’une vie entièrement vécue. On la suppose lointaine alors qu’elle peut être très proche. Ces enfants partis tracent prématurément une voie vers la mort à leurs propres parents, au nez et à la barbe de toute logique chronologique.
Ces parents… d’ailleurs comment peut-on dire « orphelins » ? Il n’y a pas de mots pour qualifier cet état de parents ayant perdu leur enfant. C’est tellement inconcevable que la langue s’est oubliée là-dessus. Cela fait donc sens, à l’évidence ! Mais s’ils sont amputés quant à eux, dans leur descendance, sont amputés dans leurs liens du sang, dans leur devenir, les fratries victimes de la douleur de voir mourir un frère ou une sœur, tant attendu, tant aimé, tant jalousé. Et les parents, pris au piège de leur mutisme ou de leur enfermement, peinent à se pencher à leur chevet en leur accordant l’attention et les bercements psychologiques espérés.
Le face à face avec les autres, société, amis, collègues, famille élargie dessine une nouvelle carte des relations et des échanges que l’on dit humains et désamorce bien des illusions sur la solidarité. Par ailleurs, la confrontation à l’autre, au regard de l’autre, à sa parole, dérange et gêne l’indispensable silence et l’indispensable solitude nécessaires à l’intériorisation de l’impensable, de l’inattendu, pour suivre en soi la sinuosité incontrôlable de la souffrance.
Invariable sera l’incidence sur le couple qui se solidifie ou au contraire se désagrège face à l’épreuve, l’agressivité faisant écho à la culpabilité omniprésente.
De la traversée de pareil traumatisme, on peut sortir grandi, conscient du prix de la vie et de l’importance de savoir ce que l’on en fait. On y perd sa naïveté, son insouciance, sa légèreté, pour se faire lester par le poids de l’avenir que l’on devine à jamais opaque. Ce genre de rencontre, de prise en compte de notre réalité d’être humain, de nos limites, c’est mieux de la faire le plus tard possible ; mais quand elle est là, comment continuer d’avancer, de construire, de vivre, sans se perdre dans les leurres des traitements ou des consommations factices de notre monde moderne qui refoule l’idée même de la mort ?
Ceux qui s’en relèvent, savent jusqu’où l’on peut tomber, et la stabilité de cette certitude les conduit à être aptes à communiquer leur force à autrui…
Mais nous autres, lecteurs, ne pourrons pas rester indemnes.
Florence Plon